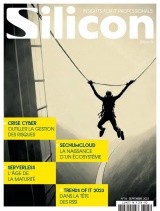CITE DES SITES : Internet trouve tout sur les grands magasins

Au delà des polémiques, Internet nous révèle l’histoire de la Samaritaine et des premiers grands magasins de Paris…
Quand, stupidement, Léon Daudet qualifia de stupide le 19ème siècle, il ne se rendait pas compte de tout ce que ces années si troublées avaient apporté au développement, au progrès, sous toutes ses formes. Entre autres nombreuses choses naquirent au 19ème siècle les grands magasins, concept nouveau qui, révolutionnant le commerce, changea le mode de vie des Français. Émile Zola dans ‘
Au bonheur des dames se fit le chroniqueur de la naissance du phénomène et le site https://expositions.bnf.fr/zola/bonheur/ est prodigue en informations et surtout en documents photographiques. Il convient de s’y attarder longuement car il montre comment « Le développement des grands magasins traduit bien les mutations économiques et sociales de l’époque. » Le grand magasin est un phénomène de grande ville et de beau quartier. Les succursales dans des quartiers suburbains n’ont jamais eu de succès. « On trouve tout à la Samaritaine » affirme depuis longtemps un slogan publicitaire. Tout et, actuellement, des difficultés. Le magnifique édifice a fermé et seul dieu sait quand il rouvrira. On a mal su assurer la conservation de cet ensemble, témoin d’une époque et, à ce titre, classé comme monument historique. Résultat : si un feu éclatait, l’incendie serait infiniment rapide et désastreux. On lit sur lemonde.fr du 18 janvier qu’un « rapport décrit quatre scénarios sur l’enchaînement des événements qui ont pu conduire à la fermeture du grand magasin, pour finalement n’en retenir qu’un seul. « La Samaritaine n’était pas ‘l’affaire’ qu’il (le groupe LVMH) avait pensée« , lit-on. Mais « fermer n’étant pas envisageable » pour une question « d’image« , « il faut donc être contraint de fermer« . « C’est là où le rapport est le plus sévère : « Il apparaît de manière évidente que la direction de la Samaritaine utilise de manière abusive le principe de précaution. Elle recourt à une argumentation catastrophiste afin de justifier une position volontairement dénuée de mesure. Elle explore le champ des possibles et retient le pire des scénarios éventuels comme quasi certain (…) Il s’agit d’affoler suffisamment les salariés et l’opinion publique pour que la décision de fermeture s’impose à elle« .» Une petite encyclopédie très vivante, www.wikimania.org/ nous raconte en peu de mots l’histoire de la Samar : «La Samaritaine est le nom d’un grand magasin parisien, fondé en 1869, par Eugène Cognacq et Marie-Louise Jay, son épouse, une ancienne première vendeuse du rayon costumes du Bon Marché. « Ernest Cognac commença un petit commerce dans la rue de la Monnaie en 1869. Marié avec Louise Jay, le couple décide d’agrandir leur magasin, qui, prospérant, s’étend et donne naissance en 1900 aux Grands Magasins de La Samaritaine du nom de la fontaine située dans le quartier qui représentait la samaritaine des évangiles. « S’inspirant des méthodes commerciales d’Aristide Boucicaut au Bon Marché, Eugène Cognacq organisa son magasin en rayons gérés par de véritables «petits patrons » responsables et autonomes. Par acquisition des bâtiments proches de sa boutique, il agrandit régulièrement son magasin. Le pâté de maison est entièrement reconstruit dans les années 20, dans un style typique Art Déco (?) « La Samaritaine est le grand magasin le plus important en termes de surface de vente avec ses 48 000 m2 devançant de peu les Galeries Lafayette et Le Printemps, et son slogan publicitaire est resté dans la mémoire collective des Parisiens : «On trouve tout à la Samaritaine ». « Dans les années 90, en proie au déficit, La Samaritaine est racheté par le groupe LVMH (Louis Vuiton Moët-Hennessy) qui avait déjà racheté le Bon Marché. En juin 2005, motivé par des raisons de mise en conformité du bâtiment aux normes moderne de sécurité, ou à cause d’une restructuration comme le pense les syndicats, le magasin est fermé pour une longue période.» Le quartier du Pont-Neuf ne suffisant pas à l’activité du grand magasin, il se créa une Samaritaine de luxe, boulevard des Capucines, en face du Café de la Paix, qui ne fit pas trop ses affaires dans ce quartier abominablement cher, et disparut. À côté, il y avait le Musée Cognac-Jay dont https://www.v1.paris.fr/musees/cognacq_jay/ évoque l’histoire : « La collection du musée Cognacq-Jay a été réunie entre 1900 et 1925 par l’homme d’affaires Ernest Cognacq et son épouse Marie-Louise Jay. Fondateur des grands magasins de la Samaritaine, le couple consacra une partie de sa fortune à acheter des ?uvres et des objets d’art, avec une prédilection pour le XVIIIème siècle français. A sa mort (1928), Ernest Cognacq fit don de cette collection à la Ville de Paris. « Le musée présente un ensemble de peintures et de sculptures de qualité où les grands artistes (Lemoyne, Chardin, Fragonard) voisinent avec des maîtres moins connus (Lavreince, Saly). Des boiseries, des meubles et des objets d’art décoratif évoquent le cadre de vie de la société élégante. Autrefois présentés sur les grands boulevards, à l’ombre de la « Samaritaine de luxe« , ces témoignages d’un XVIIIe siècle familier et gracieux ont été transférés en 1990 dans le cadre intime d’un vieil hôtel du Marais, autrefois propriété de la famille Donon.» J’ajouterai que cet hôtel Donon était un vrai squelette et que chaque jour pendant des mois je l’ai vu être nourri de pierres de tailles jusqu’à qu’il redevienne présentable comme ‘véritable’ hôtel d’époque. Je pense que la collection Cognacq-Jay est plus à sa place dans le Marais que boulevard des Capucines et que son transfert a du entraîner d’intéressants mouvements financiers. Le même site nous apporte de nouveaux éclairages sur les Cognacq-Jay : « Théodore-Ernest Cognacq est né le 2 octobre 1839 à Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). À l’âge de 12 ans, la ruine puis le décès de son père le contraignent à quitter l’école pour gagner sa vie comme marchand itinérant à La Rochelle et Bordeaux. Ernest Cognacq tente ensuite sa chance dans plusieurs grands magasins parisiens : rejeté des Magasins du Louvre, il réussit à se faire embaucher à La Nouvelle Héloïse et y rencontre sa future femme, Marie-Louise Jay (1838-1925). « Cognacq travaille dans plusieurs maisons parisiennes avant de s’établir à son compte en 1867, rue Turbigo, Au petit bénéfice. Il fait faillite, repart sur les routes de France, puis retente sa chance dans la capitale comme camelot en s’installant dans la corbeille de la seconde arche du Pont-Neuf, à l’emplacement de l’ancienne pompe hydraulique de la Samaritaine (détruite en 1813) où il reçoit alors le sobriquet de Napoléon du déballage. « À 30 ans, ses économies reconstituées, Cognacq sous-loue le local d’un café qui occupait la rotonde située à l’angle de la rue du Pont-Neuf et de la rue de la Monnaie, qu’il renomme Au petit bénéfice. Il entend ainsi profiter de la clientèle des Halles et des magasins d’À la Belle Jardinière installés depuis 1867 de l’autre côté de la rue du Pont-Neuf (actuel magasin Conforama). « La réussite survient enfin : en 1871, il loue le local transformé en boutique et prend deux employés. L’année suivante, Cognacq s’unit à Marie-Louise Jay, alors première (vendeuse) au rayon confection du Bon Marché. À force d’économies le couple devient propriétaire de sa boutique, alors baptisée La Samaritaine (magasin n°1 de La Samaritaine, à présent magasins Kenzo, Séphora et Zara), avec un chiffre d’affaires de 300 000 francs. « Les affaires prospèrent grâce aux principes de vente novateurs des époux Cognacq (prix fixes et affichés, possibilité d’essayer les vêtements?) : en 1882 leur chiffre d’affaires s’élève à 6 000 000 francs, puis à 40 000 000 francs en 1895 ; en 1925, le milliard est dépassé.» Wanadoo.fr nous en dit plus en insistant sur le ‘social’ et en expliquant les raisons du déclin d’une grande entreprise : « En 1914, les Cognacq transforment leur maison en société en commandite par actions: 65% des bénéfices sont distribués chaque année au personnel, qui est par ailleurs actionnaire pour moitié du capital. Cette participation sera réduite à 30% lors de la transformation du groupe en société anonyme en 1973. « Imprégnés de militantisme social, Ernest et Louise se font mécènes (musée Cognacq-Jay, qui recevra les collections d’oeuvres d’art), fondateurs de bonnes oeuvres (le prix Cognacq-Jay qui récompense chaque année une famille nombreuses méritante) et de diverses institutions (maternité, maison de retraite, école d’enseignement ménager, maison de repos, orphelinat). « Ils meurent dans le courant des années 20. Leur neveu Gabriel Cognacq leur succède avant de céder sa place à la famille Renand. « Le déménagement des Halles, situées à proximité, pour Rungis au début des années 70, porte un coup à la « Samar« : les épouses des riches commissionnaires ont longtemps dépensé sans compter à tous les étages, privilégiant fourrures – longtemps le rayon fut le plus important de Paris – et diamants. « Les nouvelles générations délaissent les produits quelquefois désuets proposés sur 70.000 m2, au profit des enseignes spécialisées installées dans le forum des Halles. « Pour contrer cette concurrence, la Samaritaine se lance dans la publicité décalée, où la reine d’Angleterre y achète sa couronne, Raymond Poulidor son maillot jaune et King-Kong balance sa bien-aimée au pied du magasin. En vain. La « Samar » continue à accumuler des pertes.» Un autre grand magasin a disparu il y a quelque trente ans : le Louvre où il semblait, sur la fin, y avoir plus de vendeuses que de clients. Il s’est avantageusement transformé en Louvre des antiquaires. Le Printemps et les Galeries Lafayette semblent avoir une existence plus quiète. Quant au Bon Marché qui appartient aujourd’hui au même groupe que la Samar, il a eu une naissance comparable à la sienne : « Aristide Boucicaut, né le 14 juillet 1810, débutera sa carrière comme commis dans la boutique paternelle. Il suivra, à l’âge de 18 ans, un marchand ambulant qui vendait des étoffes, s’installera à Paris en 1829, deviendra vendeur puis chef des rayons des châles au Petit Saint-Thomas, rue du Bac, en 1834. Ce magasin de nouveautés s’inspirait de la philosophie de Saint-Thomas d’Aquin : le mariage de la foi et de la raison. « Aristide Boucicaut épousera Marguerite Guérin en 1836. Née le 3 janvier 1816 à Verjux, en Saône et Loire d’une « fille-mère » et d’un père disparu sans laisser d’adresse, Marguerite montera à Paris à la mort de sa mère, à l’âge de 13 ans. Elle travaillera chez un blanchisseur, rue du Bac, avant de placer ses économies dans un petit « bouillon-traiteur » qui deviendra la cantine d’Aristide. « La première pierre du premier grand magasin parisien sera posée le 9 septembre 1869, durant le grand boom économique du Second Empire. Les travaux seront confiés à l’architecte Louis Charles Boileau et l’ingénieur Gustave Eiffel, deux pionniers de l’utilisation fonctionnelle du fer (pour rendre possible l’installation de larges baies vitrées) et du verre (pour permettre à la lumière naturelle d’entrer). « Aristide Boucicaut adaptera l’architecture de ce magasin à l’élargissement de la consommation, aura recours aux relations publiques et à la publicité, permettra à chaque employé de devenir progressivement second, puis chef de comptoir et plus tard gérant, créera une Caisse de Prévoyance pour les salariés alimentée chaque année par une somme prélevée sur les bénéfices de l’entreprise, puis d’une caisse de retraite ouvrant droit à une pension après vingt ans de service. » (https://www.insecula.com/) On voit donc que d’une rive à l’autre le Bon Marché et la Samaritaine eurent des destins et des aspirations proches. J’ai trouvé dans le Journal de Jules Renard, qui est consultable sur Internet (https://abu.cnam.fr/) cette note émouvante : « Pasteur se présente chez madame veuve Boucicaut, la propriétaire du Bon Marché. On hésite à le recevoir. «C’est un vieux monsieur », dit la bonne. «Est-ce le Pasteur pour la rage des chiens ? » La bonne va demander. «Oui», dit Pasteur. « Il entre. Il explique qu’il va fonder un Institut. Peu à peu il s’anime, devient clair, éloquent. «Voilà pourquoi je me suis imposé le devoir d’ennuyer les personnes charitables comme vous. La moindre obole…» — «Mais comment donc ! » dit Mme Boucicaut avec la même gêne que Pasteur. Et des paroles insignifiantes. « Elle prend un carnet, signe un chèque et l’offre, plié, à Pasteur. «Merci, madame ! dit-il, trop aimable. » Il jette un coup d’oeil sur le chèque et se met à sangloter. Elle sanglote avec lui. Le chèque était d’un million.» C’est-à-dire le salaire mensuel de dix mille ouvriers !