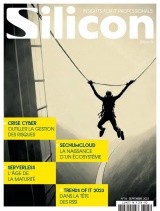Frédéric Bordage, GreenIT.fr : « Sensibiliser cette industrie prendra toute une génération »

Créateur du site GreenIT.fr il y a plus de quinze ans, Frédéric Bordage a contribué à sensibiliser et à mobiliser les acteurs de la filière IT sur l’urgence d’adopter des démarches de sobriété numérique. Pour Silicon, il revient sur les enjeux d’une rencontre entre numérique et développement durable.
En 2004, vous lanciez GreenIT.fr, devenu un portail de référence. Comment le sujet a-t-il évolué depuis lors ?
Frédéric Bordage- La rencontre entre développement durable et numérique est née sous le prisme du « green IT ». Au début, on était dans une recherche de réduction de coûts, environnementaux, sociaux et économiques. Seize ans plus tard, cette démarche commence, pour les entreprises qui s’y intéressent sérieusement, à porter ses fruits. Et à s’industrialiser.
On me demande de plus en plus comment transformer les contraintes environnementales et sociales en facteurs d’innovation et de différenciation : l’accessibilité, le respect de la vie privée… et l’écoconception.
En gros, comment je fais pour fabriquer Google plutôt que Yahoo. C’est-à-dire un service tellement simple, sobre, efficace, tellement centré sur l’essentiel que les gens vont l’acheter. C’est ce basculement d’une simple réduction de coût vers la création de valeur ajoutée qui fera le succès de la rencontre entre numérique et développement durable.
Les entreprises françaises ont donc acquis le « réflexe écoconception »…
Il y a encore un gros travail d’éducation à accomplir, à la fois pour industrialiser la démarche et la faire reposer sur des données objectives. Les entreprises ont tendance à se polariser sur les usages, sujets à une focalisation médiatique (video bashing, suppressions des e-mails, moteurs de recherche dits écolos, alors qu’il n’en est rien…). Seules les plus avancées commencent à parler d’écoconception de leurs services numériques.
De manière générale, on va d’abord s’intéresser à réduire les impressions, à allonger la durée de vie des postes de travail et à améliorer l’efficience énergétique du datacenter.
Ce qui délivre le plus, c’est le réemploi. Il faut cependant que les applications fonctionnent sur des équipements vieillissants. Aujourd’hui, on n’y est pas du tout. Sur le premier intranet que j’ai déployé en 1998, un serveur à 256 Mo de RAM tenait 1000 utilisateurs. Aujourd’hui, 256 Mo de RAM, c’est une calculatrice. Nous sommes devenus très inefficaces pour tirer parti des ressources physiques à notre disposition. Dans le même ordre d’idée, il faut aujourd’hui 171 fois plus de mémoire vive pour faire tourner le traitement de texte Word, qu’à l’époque de Windows 98 avec la suite Office 97.
Autre sujet qui n’est pas mis en œuvre malgré son efficacité : réduire le taux d’équipement. L’augmentation des impacts environnementaux par utilisateur est souvent liée au déploiement du deuxième ou du troisième écran 24 pouces.
Parmi les leviers qui commencent à être mis en œuvre, il y a le choix de l’électricité que l’on consomme. Des entreprises comprennent que l’énergie hydraulique (barrages sur un fleuve, conduites forcées à la montagne…) est nettement plus performante que le kWh électrique français standard. On progresse aussi du côté des impressions. La quantité de pages par an et par utilisateur a fondu, avec, en parallèle, une augmentation assez importante du taux de papier recyclé.
Concernant les datacenters, cela fait longtemps que les entreprises font des efforts importants. Il n’est pas rare d’en voir atteindre des PUE – Power Usage Effectiveness – autour de 1,5, soit deux fois moins qu’il y a 15 ans.
![]() Existe-t-il des cadres méthodologiques pour industrialiser ces démarches ?
Existe-t-il des cadres méthodologiques pour industrialiser ces démarches ?
Concernant la quantification des impacts environnementaux, il y a un cadre internationalement reconnu : l’Analyse du cycle de vie. Il repose sur les normes ISO 14040 et ISO 14044, dont la dernière version date de 2006. Cependant, aucune méthodologie référente ne s’est développée sur cette base.
Le projet de recherche NegaOctet a cette vocation. Il fait l’objet d’une dizaine de projets pilotes, sous le regard du CNRS, de l’Ademe, etc. Le temps que tout se fasse dans les règles de l’art, on devrait pouvoir être prêts avant fin 2021. La demande est en train de naître en Europe, alors, on essaie d’identifier, à ce niveau, un projet qui permettrait de financer NegaOctet et de le sortir du giron français.
Vous estimez que la phase de fabrication représente l’essentiel de l’empreinte environnementale du numérique. Y a-t-il des signaux encourageants sur ce front ?
Les fabricants ont notablement progressé au niveau de l’écoconception des équipements professionnels. Ils parviennent à suivre la loi de Koomey, qui dit que le nombre de traitements par joule double tous les deux ans. Il faut dire qu’ils n’ont plus le choix : les entreprises soucieuses du TCO de leurs postes de travail savent bien que le coût d’acquisition est une brindille et qu’il vaut mieux acheter des ordinateurs dont on peut remplacer des composants.
Pour les équipements grand public, c’est autre chose. Mais on constate une certaine pression au niveau de la société civile, quand on voit Halte à l’obsolescence programmée (HOP) qui intente des procès à Apple ou Epson pour que leurs équipements soient plus modulaires.
Si on veut que les gens utilisent plus longtemps leurs équipements, il va falloir allonger les durées de garantie, de support technique… et leur proposer des mises à jour plus longtemps.
En dissociant clairement les correctives des évolutives, ce qui n’est plus du tout le cas depuis l’ère des smartphones. À partir du moment où vous donnez aux utilisateurs les moyens, ils adhéreront. Que ce soit des appareils paramétrés pour imprimer par défaut en recto verso noir et blanc ou des services numériques qui ne font pas exploser leur forfait 4G.
Peut-on rêver, pour les aider, d’un « Yuka du numérique » ?
Les écolabels en proposent déjà une forme. Il y a aussi l’indice de réparabilité, qui sera disponible à partir du 1er janvier 2021 ou 2022, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, sur les smartphones et les laptops pour commencer. En ce qui concerne les services numériques, en revanche, c’est plus difficile à mettre en œuvre. L’évolution d’un site web est tellement rapide que l’on aura du mal à assurer que la note attribuée le 1er janvier sera encore juste le 1er mars.
Où en sont les institutionnels ?
Le sujet est « bankable ». Il existe un fort engouement, mais en ordre dispersé. Les acteurs institutionnels comme l’Ademe et l’Arcep tentent depuis peu de faire collaborer tout le monde. Le deuxième sujet est que, pour quantifier actuellement les conséquences environnementales d’un SI ou d’un service numérique, on ne peut accéder à des facteurs d’impact sans se ruiner ou passer par les bureaux d’études qui ont mis dix ans à forger les indicateurs un par un, à la main.
De longue date, nous appelons les pouvoirs publics à mettre un ticket sur la table pour passer ces données en open source pour que nous puissions les utiliser, les enrichir, en faire des méthodes de calcul et des référentiels communs. Tous les outils sont disponibles ou le seront bientôt, ce n’est donc plus qu’une question de volonté politique et économique.
Dans quelle mesure le temps nous est-il compté ?
La problématique d’hygiène numérique vaut pour les utilisateurs, les développeurs, mais aussi les product owners. Il faut leur expliquer lesquelles, parmi les 25 fonctionnalités qu’ils veulent intégrer à la page d’accueil, intéressent vraiment les usagers. Sensibiliser cette industrie prendra toute une génération, mais peut-on vraiment attendre une génération ?
Cela peut paraître dingue, mais le numérique est une ressource critique qui pourrait être épuisée dans 30 à 60 ans. C’est fabriqué avec du pétrole, des métaux critiques, toutes ces fameuses ressources naturelles non renouvelables dont on découvre que les stocks sont en train de se vider très vite.
Évidemment, dans 60 ans, il y aura encore de l’or, du cuivre, de l’argent… mais à quel prix et à quel coût environnemental ? Le numérique risque de devenir une « ressource de riches ». Seuls ces derniers pourront accéder à la culture, à l’enseignement, aux soins grâce au numérique. Est-ce le monde qu’on a envie de léguer à nos enfants ?
Si ce n’est la finesse de gravure, un ordinateur est toujours fabriqué comme il y a 20 ans. Comment peut-on croire que nous allons être capables de remplacer des métaux critiques et des dizaines d’autres matières en moins de 30 ans ? C’est pour cela que l’on a forgé l’expression « sobriété numérique » : en attendant, soyons de bons pères de famille et gérons avec beaucoup plus de parcimonie cette ressource que l’on épuise.
La réflexion des pouvoirs publics semble axée essentiellement sur les gaz à effet de serre…
En France, comme dans le reste du monde, le climat monopolise l’attention. Or, à ne s’intéresser qu’à la réduction de la consommation électrique et des gaz à effet de serre, on passe à côté de sujets tout aussi importants : épuisement des ressources abiotiques, eutrophisation, acidification, tensions sur l’eau douce, etc. Quand on a huit trous au fond d’une barque, il faut tous les boucher pour ne pas couler. Ne s’intéresser qu’à un seul, cela ne résout pas le problème.
Plus grave, une dissonance cognitive est en train de s’installer et de créer une forme de mythe. L’industrie numérique nous vend actuellement une vision d’un avenir où nous avons tous des voitures autonomes pilotées par des IA et qui émettent des gigaoctets de données. Cet avenir amplifierait et accélérerait considérablement l’effondrement en cours.
Ne peut-on pas imaginer plutôt un « monde de demain » sans voitures autonomes blindées d’IA, mais dans lequel le numérique porterait d’autres enjeux sociétaux critiques pour la résilience de l’humanité ? Imaginez qu’à cet instant, j’enlève tout le numérique : transactions financières, feux rouges, contrôle aérien… On serait dans une forme de « décroissance numérique » subie, un « big crunch ». J’ai plutôt envie d’une « sobriété numérique heureuse », si on doit jouer avec les mots.
En quinze ans de travaux, avez-vous identifié un « point d’inflexion » ?
Il y a eu, en 2013-2014, nos travaux avec Émile Meunier et Laetitia Vasseur – qui ont ensuite cofondé Halte à l’obsolescence programmée – dans le cadre de l’élaboration de la loi consommation. Même si les sujets ont maturé et que le vocabulaire a évolué, nous avions esquissé le cadre de ce dont on parle aujourd’hui : réemploi, reconditionnement, durée de garantie…
C’est en mars 2018 que l’on a constaté une véritable accélération avec la publication du livre blanc « Numérique et environnement ». Les pouvoirs publics ont alors commencé à évoquer le sujet et la société, dans son ensemble, s’est activée. Les parties prenantes ont senti venir la législation. En octobre 2019, nous avons publié notre étude sur l’empreinte monde. Puis, en juin 2020, nos travaux sur l’empreinte France. Entretemps, nous sommes parvenus à apporter notre pierre à l’édifice de la loi Agec [antigaspillage et économie circulaire, N.D.L.R.], par exemple sur la dissociation des mises à jour logicielles.
Aujourd’hui, on en est à une proposition de loi à l’étude au Sénat. Une obligation d’écoconception des sites web de l’État y est inscrite. Ce texte est une première mondiale. Mais pour que cela fonctionne, il faut qu’on ait envie de le mettre en œuvre. On n’est pas dans une démarche coercitive qui nous vaudrait de nous mettre l’industrie à dos. Utilisons judicieusement les ressources dont nous disposons. Les experts se réuniront ensuite pour déterminer ce que l’on insérera dans le référentiel et qui permettra de définir le niveau d’écoconception.